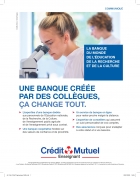Le passage du cyclone Chido a frappé Mayotte le 14 décembre, premier jour des congés de fin d’année pour les écoliers Mahorais qui, normalement, ne devaient pas reprendre le chemin des classes avant la rentrée prévue initialement le 13 janvier.
Début janvier, la ministre annonçait déjà une reprise à partir du 27 janvier, échelonnée selon les possibilités des établissements. L’État semble peut-être enfin prendre la mesure de la catastrophe qui a frappé cette île de l’Océan indien, proche de Madagascar.
L’île compte au global quelque 7 400 enseignants et 234 établissements scolaires (tous niveaux confondus) pour un total de 117 000 élèves. On dénombre 186 écoles maternelles, élémentaires et primaires réparties dans 11 circonscriptions qui comptent chacune entre 4 500 et 6 000 élèves.
L’académie compte également 22 collèges et 11 lycées polyvalents. La population mahoraise est jeune (un habitant sur deux est un enfant) et l’arrivée massive et régulière de migrants avant la catastrophe affectait déjà un système très fragile.
Les effectifs par classe sont très importants et dans le premier degré, les rotations d’élèves (classe le matin ou l’après-midi) existent depuis les années 2 000 pour faire face à l’afflux d’élèves.
La loi pour la confiance, publiée en juillet 2019 et ses décrets d’application dans la droite ligne des engagements du plan d’avenir pour Mayotte, a permis la création d’une académie de plein exercice au 1er janvier 2020, se substituant au vice-rectorat.
Ainsi une organisation administrative similaire à celle des académies de droit commun ultramarines, sous réserve de la répartition des compétences spécifiques à Mayotte entre l’État et les collectivités, est désormais en place. Le rectorat conserve la maîtrise d’ouvrage des constructions, de l’entretien et des fonctionnements des collèges et lycées (avec la construction de 4 lycées et 8 collèges dans le plan prévisionnel des investissements).
Un vaste chantier de constructions, de rénovations et d’agrandissements des établissements scolaires de l’île était en cours avant le cyclone (le lycée des métiers de Longoni, les lycées de Kwalé, Chirongui et M’tsangamouji, la restructuration des collèges de Tsimkoura et de Kani-Kéli).
L’extension du bâti est un des enjeux majeurs du système éducatif à Mayotte pour répondre aux sureffectifs encore constatés. Par ailleurs, des cuisines centrales et satellites devaient voir le jour, pour le bien-être des élèves, mettant fin au système de collations existant actuellement : pour de très nombreux enfants isolés, l’école est le seul endroit où il leur est possible de manger un unique repas journalier. L’accès à l’eau potable, à l’électricité et à un habitat en dur n’est pas non plus assuré pour tous les élèves de Mayotte. La situation des Mahorais et des Comoriens sans papiers était déjà précaire pour grand nombre d’entre eux : cette situation s’est aggravée depuis Chido.
Par ailleurs, si la plupart des établissements scolaires du territoire sont classés en Réseau d’Éducation Prioritaire (REP), depuis 2018, seulement 71 écoles et 9 collèges ont été classés en REP+.
Les conséquences du cyclone Chido sur les infrastructures scolaires
Les vents violents (jusqu’à 230 km/h) et les pluies torrentielles du cyclone ont durement affecté l'île : l’administration, les enseignants et les élèves se trouvent confrontés à des défis sans précédent pour que la reprise des activités scolaires puisse avoir lieu dans des conditions acceptables.
Le lycée Younoussa Banama à Mamoudzou avant Chido
Le lycée Younoussa Banama à Mamoudzou après Chido
Salle de classe du lycée Younoussa Banama
Mayotte compte également 3 500 étudiants, dont une majorité d’entre eux sont inscrits à l’université de Mayotte, les autres étudiants suivant des formations paramédicales, des BTS ou des classes préparatoires aux grandes écoles. Le BTS célébrera ses 22 ans cette année et le Centre Universitaire de Formation et de Recherche existe depuis 10 ans.
Comme tous les Mahorais, les étudiants de Mayotte et les personnels du service public de l’enseignement supérieur ont été durement touchés par le cyclone Chido. Les installations de l’université sont partiellement détruites. Aux destructions causées par le cyclone se sont parfois ajoutés des pillages de matériel informatique ou d’EPS et de fournitures scolaires, ainsi que des dégradations.
Etat des lieux post-cyclone
Marion (prénom fictif par respect d’anonymat), collègue enseignant l’histoire-géographie dans un collège de Mayotte, témoigne : « par chance mon logement a été épargné mais nous sommes restés 28 jours sans électricité, c’est-à-dire sans possibilité de conserver des aliments, sachant que la température dépasse souvent les 40°C en cette saison. Les vols commerciaux étaient suspendus et j’ai pu partir pour Paris seulement le 2 janvier pour un retour le 15. C’est court pour souffler un peu. Il faut savoir que nous n’avons vu personne dans notre rue si ce n’est EDM (Electricité De Mayotte) au bout de 15 jours. Le déblayage a été fait par les voisins et la situation en janvier demeure difficile sur un plan sanitaire : il y a des mouches partout et encore plus de rats que d’habitude. »
L’impression qui domine est d’avoir dû gérer la situation sans aide aucune pendant plusieurs jours : certains collègues ont perdu leur logement et peinent à se reloger, comptant sur les groupes WhatsApp d’entraide plutôt que sur le rectorat.
En outre, des contractuels devaient arriver en janvier pour la rentrée. Dans ces conditions, alors qu’il manque déjà des logements pour les personnels en place, comment les accueillir ? Notre collègue s’inquiète aussi pour ses élèves pour lesquels elle a créé un groupe Instagram.
Les échanges sur le réseau social montrent bien l’angoisse des élèves : « Moi je suis plus là-bas, nos maisons sont détruites mais ça va aller ». “Comment te sens-tu ?” « Pas très bien » « Est-ce qu’on aura cours ?» « Est-ce qu’on aura des professeurs puisque j’ai entendu dire que certains sont partis ? »
La crainte principale est la pénurie d’enseignants car selon les situations particulières (problèmes médicaux, perte de logement), le déficit pourrait s’aggraver. Actuellement le rectorat peine déjà à recruter les contractuels nécessaires car enseigner à Mayotte n’attire plus les titulaires. En effet à partir de la rentrée 2017, les décrets 2013 ont pris leur plein effet avec l’instauration de l’ISG (Indemnité de Sujétion Géographique) pour tous les collègues entrant à Mayotte. Ils ont marqué un recul notoire des compensations financières par rapport au système antérieur.
La baisse du plafond de l’abattement fiscal, la fiscalisation des indemnités, le refus d’augmenter l’indexation à hauteur du coût de la vie, le versement de l’ISG (indemnité de sujétion géographique) à un seul agent par couple, le blocage au premier indice du calcul de l’ISG, la pénalisation en cas de départ avant 4 ans, etc., n’ont pas contribué à rendre le territoire plus attractif, d’où un recours aux contractuels à Mayotte bien supérieur à ce qui est constaté dans les autres académies.
La rentrée fin janvier
La rentrée administrative au 20 janvier a surtout été l’occasion de faire le point ; les travaux de nettoyage et de consolidation sont en cours mais la situation est très différente selon les établissements, allant de quelques dégâts mineurs jusqu’à la destruction partielle, voire totale. Des préavis de grève ont été déposés par différentes organisations syndicales au vu des conditions de vie précaires prévisibles pour les personnels et les élèves. Le lundi 27 janvier, une manifestation d’importance a eu lieu dans les rues, mobilisant un grand nombre d’agents publics, dont ceux de l’Education nationale.
Du côté du rectorat, le discours se veut rassurant : « On aura quelques pertes », mais « on aura une grosse majorité d’enseignants présents sur le territoire » pour la rentrée scolaire, assurait le mardi 14 janvier sur France Culture Jacques Mikulovic, le recteur de Mayotte.
La ministre Elisabeth Borne a quant à elle finalement annoncé dans un courrier le report de la rentrée scolaire sur l'archipel un mois après le passage du cyclone Chido. Ce report « répond aux attentes du personnel et des maires. La ministre a été très à l’écoute », réagit le recteur. « Les personnels de direction demandent du temps pour remettre en ordre les établissements. Il va falloir aussi remettre en ordre l’état d’esprit des enseignants », ajoute-t-il. Le personnel éducatif, comme la majorité de la population, a été traumatisé, certains ayant perdu leur logement. « Ce qui mine le plus les enseignants, c’est que leurs logements n’ont pas été encore réparés (...) mais on aura une grosse majorité d’enseignants présents sur le territoire », rassure Jacques Mikulovic.
Marion, elle, n’imagine pas un retour à la normale dans son établissement : « nous sommes en REP, avec environ 30 élèves par classe et toutes les plages horaires, même entre 12 heures 30 et 13 heures 30, étaient déjà utilisées. Or, nous avons maintenant des classes non praticables… ». Le système de rotation sera nécessaire et intensifié : une perte d’heures de cours qui pénalisera en premier lieu les classes à examen.
Il semble d’ailleurs que la rentrée du 27 janvier ait été plus un recensement des élèves présents, une reprise de contact avec des adolescents éprouvés psychologiquement ayant besoin d’une aide spécifique par des professionnels : « Nous n’avons obtenu pour l’instant qu’une semaine de présence d’un psychologue et nous sommes à la capitale, Mamoudzou ».
D’après le ministère, trois permanences installées dans les établissements scolaires accueillent sur place les personnels pour leur proposer une écoute et un soutien psychologique. Ces permanences seront renforcées par le déploiement de trois cellules d’urgence médico-psychologique (CUMP) de l’Agence régionale de santé (ARS) dans le centre, le nord et le sud de l’île.
Un service d’écoute téléphonique (0 805 500 005), mis en place en lien avec la MGEN, est accessible gratuitement 24h/24 et 7j/7 pour l’ensemble des agents du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative.
Les enseignants réclament néanmoins des professionnels formés sur place car tous les établissements ne disposent pas d’assistant(e) social(e), d’infirmier (e) ou de psychologue. Des formations accélérées pour savoir repérer la détresse des adolescents sont déjà à l’œuvre pour les enseignants, mais qu’en est-il de leur propre détresse ? Marion* pense que « la rentrée va être très dure au-delà du logistique, j’ai peur que la charge mentale des professeurs soit sous-estimée et qu’on nous en demande trop ».
Dans le premier degré, une autre enseignante nous explique qu’elle travaillera par rotation : une semaine en cours de 7 heures à 10 heures, la suivante de 10 heures à 12 heures 30 et la troisième de 13 heures 30 à 15 heures 30 et sa classe sera utilisée par des maternelles sur les autres plages horaires.
Les conditions de travail et de vie n’étaient déjà pas faciles dans cette île de l’Océan indien mais les inquiétudes portent actuellement autant sur la vie quotidienne (avec par exemple un pack d’eau à 12 euros, alors qu’il est fortement déconseillé de boire l’eau du robinet) que sur les conditions d’enseignement avec une connexion Wifi instable, des enseignants ayant perdu leur matériel informatique et une chaleur écrasante qui serait difficilement supportable pour certains établissements dans lesquels le Ministère envisage pourtant d’implanter des tentes.
Le ministère prévoit aussi des cours diffusés sur Mayotte Première, via la plateforme LUMNI… sur une île où une partie des habitants ont perdu leur logement ! et n’ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins élémentaires… Comment peut-on sans frémir préconiser de suivre des cours en ligne comme s’il s’agissait de simplement reproduire le travail à distance de la période COVID qui, d’ailleurs, avait posé de nombreux problèmes, même en métropole ?
Malgré les déclarations officielles, la situation à Mayotte reste donc très difficile et les conditions d’enseignement certainement dégradées pour longtemps.
Le SNCL et la FAEN à Mayotte
Sur l’île, notre fédération FAEN est représentée par l’un de ses syndicats membre, le SAEM (Syndicat Autonome des Enseignants de Mayotte), dont nous remercions notre collègue et président, Anrifina CHANFI, grâce à qui nous avons pu obtenir les informations les plus récentes.
Le SNCL a décidé de procéder à un appel aux dons qui va former un fonds d’urgence, dont le SAEM pourra disposer pour répondre aux premières nécessités sur place. Ces dons prennent la forme d’une cotisation de solidarité à prix libre, collectée via notre plateforme habituelle de cotisation HelloAsso. La ligne de cotisation de solidarité a été placée en tête des tarifs d’adhésion sur ce site.
Comme votre cotisation syndicale, tout don que vous ferez de cette manière donnera lieu à un reçu fiscal, vous permettant ainsi d’obtenir le remboursement des deux tiers de la somme donnée sur vos impôts (même si vous n’êtes pas imposable).
Pour faire un don, rendez-vous sur notre site internet et cliquez sur « adhérer », ou bien suivez cette adresse. Vous pouvez également faire un don par chèque (dans ce cas rapprochez-vous de votre trésorier académique, ou appelez le siège national au 09 51 98 19 42.
Vous pouvez faire un don même si vous n’êtes pas adhérent du syndicat. Le SNCL vous remercie d’avance pour votre générosité.